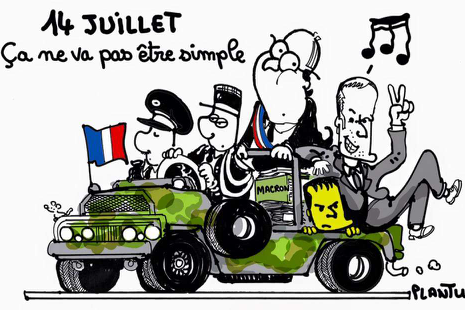«L’impôt ne contrarie pas l’évolution du capitalisme, il l’accélère ; il ne corrige pas les effets du marché et de la concurrence, il les renforce.» Cette archive sur l'inégalité fiscale comme outil des politiques néolibérales date de 1975. Le Monde diplomatique Compte certifié
Plus la différence des hommes qui la gouvernent, la masse des contribuables n’a pas une vision nette et précise de l’ampleur de l’exploitation dont elle est victime. Pour le citoyen contraint de se soumettre à « l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques », l’égalité devant l’impôt, l’équité dans la répartition, toutes les règles de la légalité républicaine et démocratique sont réputées fonder le système fiscal, au moins au niveau des intentions. Ce qui ne lui interdit pas de penser aussi que l’application laisse à désirer ou que des faveurs de fait sont naturellement obtenues par les puissants au détriment des plus faibles. L’assujetti, en effet, n’est pas naïf et il sait la relativité des pétitions de principe. Mais de là à croire réellement que l’impôt repose sur des bases exactement contraires, admettre que si la Ve République n’a pas inventé l’inégalité, elle l’a délibérément confortée, le pas n’est pas facile à franchir.
La politique fiscale n’a pas de réalité autonome. Elle est un des moyens qui concourent à la réalisation des objectifs du pouvoir. Pendant seize ans, un mot d’ordre a incarné la volonté militante du régime : adapter et moderniser l’économie nationale pour répondre au défi de la concurrence mondiale.
« Etant le peuple français, il nous faut accéder au rang de grand Etat industriel ou nous résigner au déclin » (1). L’impôt participe à cette tâche redoutable. L’injustice fiscale en est le prix.
L’histoire contemporaine est celle de la conquête du monde occidental par un groupe restreint d’entreprises géantes. Si l’on en croit les prêtres de la prospective, elles seront moins de cinq cents à détenir, d’ici à la fin du siècle, l’essentiel du pouvoir. Pour ce faire, de formidables concentrations de forces de travail et de capital, anonymes et transnationales, entraînent, dans un combat gigantesque pour l’élimination ou la soumission des moins aptes, des millions d’hommes qui n’ont d’autre destin que de servir et de subir une puissance qui les domine et à laquelle ne résistent ni l’idéologie dont elle procède ni les nationalismes qu’elle utilise. Dans cette compétition, les chances du capitalisme français, parti en retard et traditionnellement plus faible, dépendaient d’un changement rapide, d’un « effort impérieux » et d’une « réforme radicale ». Ce fut l’ambition de la Ve République d’en être le promoteur zélé et le régisseur efficace, ne concevant d’autre alternative que la maîtrise des mutations sauvages imposées par la lutte internationale ou la disparition prématurée et sans appel.
Or « la France n’est pas pleinement consciente de la portée de la révolution qu’elle vient de choisir... Il n’y a pas de plus dure contrainte que la concurrence extérieure » (2).
Y faire face exige des vertus sévères : « La tenacité, l’efficacité, la sobriété... » (3). Car « nous sommes dans l’économie de la compétition mondiale un poids moyen qui va se confronter avec des poids lourds » (4). C’est pourquoi « l’industrie française doit accentuer son effort pour réaliser des unités financières et industrielles plus importantes. Il faut aller vers des fusions, des ententes, des concentrations afin de donner à la France des entreprises à la taille internationale » (5). « L’intérêt du pays, c’est que les entreprises développent leurs profits » (6).
Dès lors, les fonctions de l’impôt sont précises :
- Favoriser, par des incitations sélectives, l’avènement de la grande entreprise capable de dominer le marché et de résister à la concurrence internationale ;
- Garantir le rendement maximum des recettes fiscales nécessaires au financement d’une dépense publique en accroissement continu ;
- S’assurer la neutralité des victimes en les anesthésiant, et la participation active des bénéficiaires en accordant des privilèges fiscaux aux détenteurs du pouvoir et de l’argent.
Après seize ans d’une gestion presque constamment assurée par un ministre remarquablement compétent, il faut reconnaître que les résultats sont à la hauteur de l’ambition. Dès lors, s’indigner de l’injustice de la fiscalité française c’est témoigner d’une naïveté certaine, faire à ceux qui nous gouvernent un procès d’intention, quand l’inégalité systématique est précisément en la matière le moyen délibérément utilisé et l’aboutissement nécessaire d’une politique.
La carotte et le bâton, ou le cynisme du prince
Il faut abandonner l’idée commune que la fiscalité des entreprises impose un régime uniforme de règles à caractère général et impersonnel auxquelles dérogeraient quelques dispositions exceptionnelles aux effets provisoires et que seule la fraude permettrait de transgresser. Pareille idée ne résiste pas à l’analyse. Il est plus vraisemblable qu’il n’y a pas deux entreprises placées sous le même régime. Chacune tend à avoir un statut fiscal personnalisé. L’optimum, c’est-à-dire la charge relativement la plus faible, est obtenu par la grande entreprise qui a prouvé ses aptitudes à dominer le marché et à affronter la concurrence internationale.
Mais la promotion et l’assistance fiscale de l’entreprise privée sont sélectives et conditionnelles.
Trois moyens y concourent :
- a) La mise hors jeu de l’immense majorité des petits, placés sous le régime du forfait. Leur chiffre d’affaires dérisoire, leur incapacité à se doter des moyens d’analyse et de gestion indispensables, leur faible niveau d’investissement les éliminent par avance de la compétition. Voués à la disparition, à la sous-traitance ou à subir la domination des plus forts, la fiscalité les enferme dans un statut d’incapable qui précipite leur régression, offrant seulement une chance, jusqu’à présent rarement saisie, à ceux d’entre eux qui tenteraient de se regrouper. Demi-soldes du capital, soumis à une tutelle pesante avec, pour les plus modestes, un système de décote et d’exonération à mi-chemin entre une sorte de SMIC fiscal et une indemnité viagère de départ.
- b) Pour les autres entreprises, une série d’incitations progressives ayant pour effet d’augmenter, par un jeu de déductions, leur capacité d’investissements en leur permettant de les effectuer en franchise d’impôt. Mais pas n’importe quelle entreprise ni n’importe quel investissement. Si la sélectivité ne procède pas d’un interventionnisme autoritaire, elle tend à réserver les avantages fiscaux de l’autofinancement à celles dont la situation permet de présumer que leur compétitivité en sera améliorée.
- c) Au-delà, les groupes les plus importants négocient directement avec l’administration, par entente contractuelle, des agréments fiscaux. Accords discrets, dépourvus de toute publicité, qui les encouragent, par une franchise partielle ou totale d’imposition, à concentrer sous leur autorité le capital de production, conquérir des marchés extérieurs, investir dans la recherche, se décentraliser et développer leur capacité de financement.
C’est le mérite de l’ancien ministre des finances d’avoir, progressivement, rationalisé l’inégalité de la fiscalité des entreprises en la mettant au service des objectifs prioritaires du Plan : concentration et compétitivité. L’impôt ne contrarie pas l’évolution du capitalisme, il l’accélère ; il ne corrige pas les effets du marché et de la concurrence, il les renforce.
Cette action n’est d’ailleurs pas limitée au secteur industriel ; elle s’étend à l’agriculture, au commerce et aux services ; elle s’accompagne de mesures spécifiques à certaines branches d’activité : sidérurgie, chantiers navals, entreprises de presse, immobilier, etc.
Mais il est difficile d’avouer que la fiscalité est créatrice d’inégalités, que l’Etat-arbitre prend délibérément parti pour le plus fort. Il est même préférable, politiquement, d’affirmer le contraire. La plupart du temps, l’hermétisme vient naturellement au secours du ministre des finances, la complexité apparente suffit à décourager les curieux. Combien de parlementaires ont avoué après coup n’avoir pas compris grand-chose au système de l’avoir fiscal malgré les explications de M. Giscard d’Estaing ? Ils l’avaient néanmoins approuvé.
Le cas échéant, on n’hésite pas, avec le cynisme du prince, à placer sous le patronage de la neutralité, ou même de la justice sociale, des mesures qui en sont la négation. Ainsi du régime de l’intéressement aux bénéfices, baptisé « participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises » alors que, par l’effet des dispositions fiscales, il serait plus justement qualifié d’« intéressement des entreprises en expansion aux contributions des salariés ». Le ministère des finances n’en faisait d’ailleurs pas mystère, révélant, dans une note explicative, que le but de cette réforme hardie était « d’associer les travailleurs à des formules de placement adaptés aux besoins de l’économie » et « de stimuler la croissance des entreprises »,toutes choses apparemment plus conformes aux objectifs de la politique fiscale qu’aux impératifs d’une meilleure justice distributive.
Les avertissements avisés ne manquèrent pas : « Par le jeu de la double exonération fiscale, l’opération change complètement de caractère. Ce n’est plus l’entreprise qui partage avec son personnel son enrichissement par autofinancement, elle le conserve intégralement. C’est la nation entière qui verse aux travailleurs une subvention, un cadeau, lequel transite pendant cinq ou huit ans dans les caisses de l’entreprise, pour des investissements que rien ne vient orienter vers les priorités de l’intérêt général. C’est un abus de langage que d’appeler cela prendre une part d’un enrichissement (7). » Le régime de l’intéressement « fait obligation au malheureux capital, dans le seul cas d’ailleurs d’entreprises très prospères, d’accepter du Trésor public des sommes qu’il lui sera interdit de reverser aux travailleurs avant cinq années (8) ». Rien n’y fit.
Depuis sept ans, les chantres du gaullisme proclament, avec naïveté ou duplicité, qu’il s’agit d’une véritable révolution, première étape d’une voie nouvelle entre collectivisme et capitalisme. Au cours d’un débat télévisé, M. Chalandon le réaffirmait avec beaucoup de conviction et une certaine émotion, au moment même où M. Giscard d’Estaing, alors ministre de l’économie et des finances, s’avisait que l’intéressement commençait à coûter bien cher au Trésor, c’est-à-dire aux contribuables, et qu’il serait peut-être temps que les entreprises participent un peu à la participation. Elles en paieront 10 % en 1974, 17,5 % en 1975, 25 % à partir de 1976. Il ne restait plus, dernière ironie, qu’à qualifier de « justice fiscale » cette correction partielle d’une vieille supercherie.
Si les résultats d’ensemble de la politique fiscale sont probants et conformes aux intentions, la morale libérale veut que la position dominante des grands groupes soit le seul fait de leur esprit d’entreprise et d’une gestion dynamique, sans aucune complicité de l’Etat qui ferait plutôt figure de gêneur. On ne trouvera donc pas de statistiques officielles permettant d’en vérifier les effets. Les éléments dont on dispose confirment, néanmoins, que la part des profits bruts échappant à l’impôt sur les bénéfices tend à augmenter avec la dimension de l’entreprise, autrement dit la charge fiscale tend à diminuer, et que le phénomène s’est renforcé au cours des quinze dernières années (9). Il s’agit d’une tendance, car la réalisation des objectifs reste partielle et imparfaite.
La fraude chronique et tolérée des petits sert de ballon d’oxygène, tempère les effets de l’action fiscale, désamorce la menace d’un nouveau poujadisme. En ignorant délibérément 20 à 50 % du chiffre d’affaires des entreprises marginales, on retarde, certes, la mutation, on évite aussi qu’elle soit remise en cause sur un autre terrain. Pour les grands, l’évasion, les jeux de sociétés fictives, les paradis fiscaux et les artifices comptables complètent avantageusement les privilèges légaux. Alors que les P.M.E. accusent fréquemment le gouvernement de « jouer à cache-cache »et de « réserver ses faveurs aux grandes sociétés », on pourrait croire le patronat satisfait. La règle du jeu veut qu’il n’en laisse rien paraître, au contraire. Son attitude : se plaindre en permanence des« charges excessives qui pèsent sur les entreprises françaises », ne jamais reconnaître avoir bénéficié d’un avantage. D’ailleurs, affirmait M. Georges Villiers, lorsqu’il présidait le C.N.P.F., « les carottes n’intéressent pas le patronat ». Il les croque, bien sûr, mais sans appétit ! Aux autres le bâton.
Dans tous les pays industrialisés du monde occidental, la croissance de la dépense gouvernementale accompagne et entretient le développement. Les commandes publiques, le financement direct ou indirect des investissements garantissent l’expansion de l’économie en évitant les crises, apportent leur soutien à une bonne part de la production privée, protègent la prospérité des grandes entreprises qui contrôlent le marché. La prise en charge immédiate d’une série de dépenses qui, telles l’éducation, la santé, la recherche scientifique, ne sont pas rentables à court terme, préserve pour l’avenir la capacité productive du pays. L’ensemble exige un dispositif capable de fournir les recettes correspondantes.
La Ve République y a pourvu, mettant en place et consolidant un diptyque qui assure une ponction maximum au moindre coût. Deux impôts, T.V.A. et impôt sur le revenu, fournissent à eux seuls les deux tiers des rentrées fiscales, le reste se partageant entre une quarantaine de prélèvements. Cet équipement lourd, directement indexé sur les prix et les revenus, connaît une croissance spontanée et automatique au rythme de l’inflation et de l’augmentation des salaires. Il entretient la première, réduit les effets de la seconde. La productivité maximum de l’impôt est ainsi obtenue, en dépit des distorsions constatées.
Sur ce plan également, priorité est donnée à la rentabilité sur l’équité. Le système réserve au gouvernement un précieux atout. Débarrassé des demandes humiliantes de création ou de majoration d’impôts, le ministre des finances n’interviendra que pour proposer généreusement, avec un grand luxe de précisions, des allégements sans conséquences, ou tirer parti du battage organisé autour des « recettes de poche » prélevées sur la classe privilégiée, étant assuré que l’essentiel lui sera fourni autrement.
Aux ponctions effectuées pour le compte de l’Etat (environ 200 milliards) s’ajoutent celles des communes et des départements, les taxes parafiscales et les cotisations sociales (127 milliards). Au total, 340 milliards de francs pour 1972 (10). Le plus souvent présentée et comptabilisée séparément, cette masse forme un tout : le Prélèvement Obligatoire Global, qui chiffre le coût des interventions publiques et permet de mesurer la pression fiscale ; en moyenne 36,3 % du P.N.B. pour les années 1968-1970, contre 34 % en Allemagne, 36,6 % en Angleterre, 43 % en Suède, 27,9 % aux Etats-Unis (11).
C’est la fonction des entreprises de servir d’intermédiaire pour la collecte de cette énorme masse ; elles en assurent les quatre cinquièmes, qu’elles prélèvent chaque année sur le contribuable anonyme : T.V.A., cotisations sociales, patente, taxes diverses... bientôt la quasi-totalité, lorsque l’impôt sur le revenu sera retenu à la source. Elles sont les fermiers généraux de notre époque, partageant avec l’Etat le pouvoir de lever l’impôt, facturant le service rendu en déduisant du bénéfice imposable les frais de gestion qu’elle entraîne, gardant les privilèges de la charge. Car les sommes ainsi prélevées sur d’autres sont laissées à la disposition de l’entreprise, sans intérêt, pendant un temps variable (un mois, un trimestre ou un an). A la limite, une société peut très bien, pendant trois mois, agir en Bourse ou spéculer sur la monnaie avec les cotisations de sécurité sociale retenues sur les salaires de ses employés.
L’univers fiscal du contribuable moyen est truqué. Les illusions dont on l’entretient le privent de toute possibilité de rencontre avec le réel. Entre les « bonne œuvres » fiscales du ministre des finances, les autocritiques absolutoires, les complaintes larmoyantes des groupes de pression, et le fumigène statistique dont on l’encense, la mythologie de l’impôt lui laisse peu de chances de comprendre ce qui lui arrive. Pour l’essentiel, chacun acquitte l’impôt sans le savoir, quotidiennement, en achetant les biens qu’il consomme, les services qu’il utilise. De 65 à 80 % du prélèvement global est ainsi assuré par l’intermédiaire de taxes et cotisations multiples.
Elles suivent toutes le même circuit anesthésiant : versées directement à l’administration par l’entreprise, intégrées dans les prix de tout ce qui est produit et commercialisé, répercutées sur le consommateur qui, chaque fois qu’il dépense 100 F, paie en moyenne 40 à 50 F d’impôts, taxes et cotisations diverses. Sans s’en apercevoir, ou presque. C’est un fait qu’il supporte sans douleur la chappe de plomb qui tombe sur lui tous les jours, mais gémit sous le poids de la plume fiscale qu’il doit porter trois fois par an au percepteur. (En moyenne chaque habitant paie 620 F d’impôt sur le revenu sur un prélèvement fiscal total de 6.600 F.)
Le paradoxe n’est qu’apparent. La mystification du contribuable rend possible son exploitation. Elle pèse d’autant plus lourd sur les ménages qu’ils consacrent une part plus importante de leur revenu à des dépenses de consommation, même de première nécessité. Comme l’a montré une étude du CREDOC (12), la pluralité des taux de T.V.A. n’apporte pratiquement aucun correctif. Comment pourrait-il en être autrement quand celle-ci taxe pareillement la SM Citroën et la 4L Renault, la robe de grand couturier et le bleu de travail, le caviar et le maquereau, et deux fois moins le séjour dans un palace de grand luxe que dans une pension de famille ?
Ainsi, la pression fiscale est la plus forte pour les revenus les plus faibles, décroît lorsque la part consacrée à l’épargne augmente, c’est-à-dire, en règle générale, lorsque le revenu s’élève. Proportionnel au prix, ne tenant pas plus compte de l’utilité de la dépense que de la situation sociale des personnes, ce formidable prélèvement est la réalité d’une fiscalité qui choisit ses victimes : petits retraités, modestes salariés, ouvriers, employés, cadres moyens chargés de famille.
L’impôt, en France, c’est l’impôt sur la consommation. L’iniquité de notre fiscalité tient d’abord au fait qu’il y tient une place beaucoup plus importante qu’ailleurs. Mais aussi à ce que, à l’autre extrémité, une minorité privilégiée a seule la possibilité d’y échapper. Elle ne s’en prive pas. Transformer les dépenses de consommation de ses dirigeants en charge d’exploitation, puis en élément du prix de revient, et les faire supporter intégralement par les autres consommateurs : telle est la voie royale du transfert légal de la charge sur les plus faibles. Car l’entreprise, c’est-à-dire ses dirigeants, puisqu’elle ne saurait consommer elle-même quoi que ce soit, est le client principal et exigeant des plus grands hôtels, des meilleurs restaurants, des trains de luxe, des premières classes d’avion, des bâtiments les plus modernes aux aménagements intérieurs somptueux, des « clubs-houses » de golf, abbayes rénovées, manoirs de chasse ou chalets de sports d’hiver où s’organisent séminaires, colloques et autres symposiums. Elle dispense aux cadres méritants, suivant leur place dans la hiérarchie, quelques faveurs et leur entrouvre les portes de l’Eden : émarger aux frais généraux.
Le bon peuple pense que tous ces fastes sont le fait de riches privilégiés qui dilapident ainsi une fortune plus ou moins bien acquise ; il ne se croit pas concerné, ce en quoi il a tort. C’est lui qui paie la facture. Tout sera transformé en charges, déduites du bénéfice imposable et transféré dans les prix. Quel locataire sait que son loyer contient une fraction du prix de la moquette moelleuse, des vitres fumées, de la climatisation, du mobilier design qui donnent au bureau de 50 mètres carrés du promoteur de son modeste appartement de banlieue, le standing qui manque précisément à son trois pièces ? Pour les responsables et dignitaires de l’Etat, les grands commis et hauts fonctionnaires, on arrive au même résultat par des voies plus courtes. Comme le remarquait Gaston Jèze, il y a près d’un demi-siècle, « la classe sociale qui a le pouvoir politique tend à échapper à l’impôt ». Allégés de certaines dépenses et de la charge qui s’y rapporte, ses revenus trouvent meilleur emploi à tirer profit des avantages accordés à l’épargne et au capital.
Le reste de la fiscalité joue un rôle secondaire. L’impôt sur le revenu représente moins de 5 % du revenu brut des ménages, 10 % du prélèvement global. Il est deux fois plus élevé en Allemagne et aux Pays-Bas, deux fois et demi en Suisse, en Angleterre, trois fois aux Etats-Unis ou en Suède. Au niveau où il se trouve en France, il est donc incapable de corriger la situation d’ensemble, quand bien même il serait équitablement réparti. Ce n’est pas le cas. Il suffit de lire le rapport du Conseil des impôts (13) pour s’en convaincre.
Privilégiant le capital par la quasi-exonération des plus-values, le prélèvement libératoire, l’effet réducteur de l’avoir fiscal, celui des déductions ouvertes aux revenus fonciers ; sous-évaluant les revenus des agriculteurs d’autant plus qu’ils sont plus élevés, incapable d’appréhender correctement ceux de nombreuses professions commerciales et libérales, l’impôt sur le revenu est surtout l’impôt de ceux dont les revenus sont déclarés par des tiers, essentiellement des salariés, cadres moyens et supérieurs. Encore que, pour les mieux payés, les indemnités diverses, les abattements et déductions forfaitaires, le jeu du quotient familial réduisent les bases d’imposition et l’effet de la progressivité.
Un dirigeant salarié, marié, deux enfants, payait en 1973 au maximum 17 % d’impôt sur le revenu si sa rémunération était de 150 000 F, 27 % si elle était de 300 000 F. Nettement moins s’il avait des revenus du capital et s’il savait se débrouiller, ce qui est souvent le cas. Car la fraude, avant d’être industrialisée (14), est artisanale. Ultime préoccupation d’un certain nombre de nantis, raison sociale d’activités qui la fabriquent et la vendent à toutes sortes d’entreprises, elle coûte très cher aux autres contribuables. Traditionnellement tolérée et pratiquée en toute impunité, elle est depuis peu dénoncée et réprimée au rythme d’« affaires » où se côtoient, entre autres, gens du milieu, fonctionnaires corrompus et dirigeants de sociétés respectables.
Il reste que le faible effet correctif du seul impôt qui ait quelque prétention à l’équité est pratiquement annulé par celui, exactement inverse, des cotisations sociales, en particulier des retenues sur salaires dont le montant est d’ailleurs plus élevé (27,5 milliards de francs en 1972). On retrouve là le visage familier d’une fiscalité qui légalise l’injustice, C’est ainsi que, par l’effet du plafonnement, le taux passe de 6,5 % pour un salaire de 10 000 F à 1,5 % pour un salaire de 200 000 F. Lorsque le revenu est multiplié par vingt, le taux de la cotisation est divisé par quatre. Rien ne peut justifier une inégalité aussi délibérément instituée et dont sont victimes les petits salariés.
On peut se persuader que la croissance prime l’équité, que l’inégal est relative et tient surtout aux effets d’une fraude trop répandue, aux difficultés d’intégrer dans le système certaines catégories professionnelles, que les avantages accordés aux entreprises ou à l’épargne sont nécessaires à un développement économique qui profite à tous ; estimer que M. Giscard d’Estaing fait ce qu’il peut pour « réconcilier les Français avec l’impôt ».
Croire cela, c’est nier la réalité d’une politique rationnelle d’exploitation et de mystification qui impose à la masse des contribuables de payer le prix de la concentration capitaliste sur laquelle une caste privilégiée, qui en tire profit, fonde son pouvoir.
Christian de Brie
Assistant à l’université de Reims, auteur, avec Pierre Charpentier, de L inégalité par l’impôt, Le Seuil, Paris, 1973, et de F comme fraude fiscale, Ed. Moreau, Paris, 1975
Source Janvier/1975
(1) Général de Gaulle, allocution radio-télévisée du 14 juin 1960, Paris, la Documentation française, 1960 (Articles et documents, no 961, 18 juin 1960).
(2) V. Giscard d’Estaing, exposé à la nouvelle faculté de droit de Paris, le Monde, « la croissance sans inflation », 29 avril 1969.
(3) V. Giscard d’Estaing, discours lors de son retour au ministère de l’économie et des finances, le Monde, 26 juin 1969.
(4) V. Giscard d’Estaing, déclaration faite devant les républicains indépendants à Clermont-Ferrand, le Monde, 20 juin 1967.
(5) G. Pompidou, interview accordée à Entreprise, citée par le Monde, 17 juin 1964.
(6) G. Pompidou, discours à l’Assemblée des chambres de commerce et d’industrie, le 28 février 1969.
(7) Professeur G. Lasserre, Au-delà du pseudo-intéressement. « Libres Opinions », le Monde, 14 septembre 1967.
(8) Marcel Loiehot, Bagatelles pour un simulacre, « Libres Opinions », le Monde,25 août 1967.
(9) C. De Brie et P. Charpentier, la Politique fiscale de la Ve République, Thèse polycopiée, Paris, 1972 (6 vol.).
(10) Rapport sur les Comptes de la nation 1972, Imprimerie nationale.
(11) Observateur de l’O.C.D.E., décembre 1972.
(12) J. Kende avec la collaboration de J. Desce, Etude des effets différentiels sur la consommation, réalisée pour le compte du commissariat au plan, CREDOC 1971.
(13) Conseil des impôts, Rapports au président de la République, 1972 et 1974.
(14) J. Cosson, les Industriels de fraude, Le Seuil.